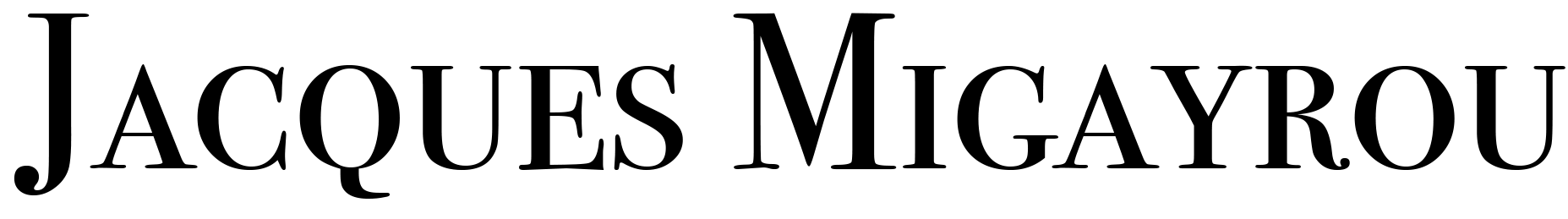Appréhender la beauté…. vouloir la saccager
Au commencement, il y a la beauté, l’éblouissement. Beauté du monde environnant, beauté des corps, des paysages.
Appréhender cette beauté.
Etre fasciné par cette beauté, submergé. Espérer l’approcher, la voir se dérober immuablement. Ne l’avoir jamais. Presque jamais.
En avoir peur. Vouloir la saccager. Alors risquer de la perdre pour toujours. Ne garder que les traces du saccage.
Beauté des corps qui semblent s’offrir, mais échappent toujours…
Femmes-fragiles, diaphanes, à portée de main, mais comme dans un rêve, elles s’avèrent finalement intouchables, défendues par une barrière de fleurs qui auraient poussé, là, à l’instant devant nous, envahissant presque tout l’espace.
Femmes-joueuses, comme ces sirènes, que nous croyons pouvoir aborder, saisir, mais qui se moquent, ironisent sous leur nez de clown, jouent de leur pied palmé plastique pour nous faire croire qu’elles sont de ce monde, alors que leur chair, chair d’écorché, dit l’appartenance à la mer, à l’outre-mer, à l’au-delà. Sans regard, elles se rient de tout leur corps, arrogantes, offensantes.
Et ces jumelles d’un autre tableau, ces presque siamoises cachées derrière leur masque africain qui s’offrent dans leur nudité espiègle, ne semblent-elles pas venues défier un rêveur, avant de s’évaporer dans le bleu des songes et des cieux ?
Et cette autre, cachée sous un masque qui n’est qu’un cri, une bouche, mais qu’elle arbore côté pile au lieu de face pour fuir, manifestement, une terreur à faire perdre la tête ? Qui oserait l’approcher ?
Ailleurs, une amazone, nue toujours, la tête et la moitié du corps évaporées dans un nuage de fumée blanche, chevauche son cheval-bâton écarlate ; talons rouges, ongles peints, elle galope sur son désir, très haut, si loin.
Femmes-fluides, formées d’unités oblongues, mouvantes ; elles dissuadent toute caresse comme si le moindre effleurement risquait de remettre en mouvement cette entité liquide, la faire couler et s’échapper. Cette même impression d’insaisissabilité se retrouve face à un autre nu, dont la cage thoracique s’envole en volutes de fumée bleue et orange.
Le bleu et rouge du réseau sanguin devient la matière même de certains corps, comme dans cette transfiguration qui découvre un trio de femmes irradié d’une lumière éclatante.
Ce passage de vie à trépas, c’est aussi cette plantureuse diva, agenouillée, suppliante, suppliciée qui nous le donne à voir ; prise dans un processus de mutation, son visage est celui d’un cadavre presque, et sous sa robe noir-crapaud, vert-corbeau, paraissent lui pousser des pattes de batracien.
La mort semble rendre sa densité au corps, le lester dans sa réalité, laissant apparaître un muscle bien dessiné, une cage thoracique, un ventre évidé ou encore le squelette d’un visage.
Beauté des corps qui ne se donnent que dans la mort…
Quand s’offre enfin le corps et la chair libérée de sa gangue, quand on croit pouvoir mettre la main dessus, il est déjà trop tard. Seule la mort se laisse saisir, alors que la beauté, le vivant, échappent toujours.
Les corps vivants ne sont-ils pas, finalement, que des leurres, mannequins de couture, simples porte-manteaux, étuis de violoncelle ? Des épouvantails à hommes ? Sans tête et pourtant auréolés parfois d’une lumière spectrale ? Ils se dérobent presque toujours. Qu’une main se pose sur cette illusion de chair et c’est deux mondes qui s’opposent : celui d’une fraternité d’hommes tristes, face à une féminité qui ne livre d’elle qu’une coque rigide, lisse, sur fond blanc aveuglant.
Hommes et femmes n’offrent qu’un miroir vide, ailleurs, indisponible. A l’instar des corps, ces visages n’invitent qu’à une communication avec l’au-delà ; c’est ce que donne à voir quatre sièges vides dans un salon, si vivants paradoxalement, habités par une présence fantomatique. On ne peut communiquer avec l’autre que dans l’absence. Et ce couple, de profil, visages de trois-quarts à peine griffonné, emprisonnés sous une masse tentaculaire de cheveux noirs qui grisaille et déprime les bustes, ne dit-il pas le poids de la présence-absence de l’autre sans regard ?
Beauté des paysages qui disent la catastrophe…
La catastrophe n’est jamais loin. Mais est-elle à venir ou a-t-elle déjà eu lieu ?
Les paysages comme les êtres sont désertés. Vides d’existence, ils ne délivrent que des traces de présence, des traits pour faire signe.
Les routes de campagne sont balisées par des bandes blanches, passages piétons dont on peut se demander qui les traverse. Et cet abris-bus tout près ? Qui protège-t-il ? Ou plus inquiétante, cette bande non continue peinte d’un rouge qui dégorge sur le bitume comme si la route elle-même saignait, en place d’être meurtrière.
En zone urbaine, au-dessus de constructions écrasantes, de hautes grues barrent de leur croix métallique un ciel accablé. Ailleurs c’est une cheminée qui se dresse, lugubre, contre un immeuble, et le sol qui les porte en est comme embrasé.
Le monde environnant n’est pas sûr, il s’avère instable, insaisissable, inquiétant.
La catastrophe, c’est l’effondrement des ciels, des colonnes, des structures du monde. Les éléments verticaux de soutien ne tiennent plus, d’autres sont déjà détruits et jonchent les sols ci et là. Reste une signalétique horizontale sanglante qui semble dire l’écrasement de l’être.
Beauté des corps-paysages qui racontent la douleur d’être séparé…
Les arbres ici, sont des corps-paysages qui souffrent, se tordent et pleurent.
Comme ce saule aux frondaisons rosées, champignon atomique menaçant, alors que dans le pré alentour, des bustes de couturières irradiés, errent comme des revenants.
Un autre, en bord de mer, laisse éclater de couleur sa douleur et crie son affliction au ciel.
Et dans cette forêt fantomatique, est-ce un couple d’arbre ou un arbre malade scindé en deux qui dit sa solitude ?
Car la catastrophe, précisément, ne serait-ce pas ce déchirement d’être séparé ? Plusieurs tableaux de couples décrivent cette illusion de continuité narcissique, ce rêve de rester toujours accolé à un autre en symétrie complémentaire. Ainsi ce diptyque où un corps d’homme replié sur lui-même est prolongé par un corps de femme ouvert et tendu vers l’extérieur, la différence de couleur marquant la séparation : rouge et bleu, couleurs de l’arrachement, du sang qui coule, du muscle mis à nu. Quand se déchire cette peau commune, reste la blessure de la solitude, de l’incomplétude.
Il semble qu’un espace commun avec l’autre pourra être retrouvé dans la lutte ou la fraternité triste, proposant un autre corps à corps, médiatisé par un ballon ou un étui de violoncelle comme dans quelques scènes de groupe. Ces objets figurent les seuls liens entre les êtres parce qu’aucune communication n’est possible, si ce n’est dans l’au-delà ou par le biais de masques et de clowneries. Reste encore le saccage.
Car saccager, c’est aussi une manière de toucher…
C’est mettre la main sur, mettre la main dans le sac. Ce saccage, cet acharnement à détruire-créer, à créer-détruire, dit que tout espoir n’a pas été tué, qu’il faut le chercher. Faire se succéder attaques et réparations, autant de tentatives de stabiliser son monde intérieur.
Jacques Migayrou nous fait partager son conflit entre l’idéal de la beauté et l’attaque de cette beauté pour faire naître, en nous, une émotion. Il peut nous atteindre, il peut nous toucher, et devant ses toiles nous ne pouvons nous dérober. C’est là la victoire de l’artiste.
Alba Blücher (Mars 2011)
Il y a de longs étirements, toujours répétés, comme de longs désirs qui se heurtent à l’espace mesuré, délimité.
A chaque fois répétées, mêmes tentatives obstinées pour aller explorer le lieu, dans une ascension verticale et franche, ou d’une manière plus oblique, plus insidieuse.
Enlacements langoureux, plis redoutables, tentacules mortelles, c’est toujours l’amour, la trahison, et la mort.
C’est l’histoire des espérances déçues, racontée dans le bleu, le rouge, l’or et le vert, ou même dans un gris qui se replie sur lui-même et reste immobile.
La vie est là, tout vibre et se broie.
Alain Spiess ( 1997 )
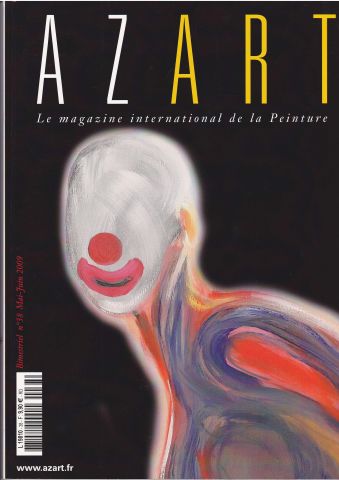
Article paru dans le n° 38 de mai/juin 2009 du magazine AZART
…………. Son geste pictural appartient au monde des passions inassouvies. Il stigmatise, avec violence des béances non refermées ………
Migayrou va chercher dans les profondeurs d’une vie écorchée, le terrain mouvant de ses recherches picturales ……..
………. ces derniers travaux traitent de le beauté inaccessible, source » d’infinies frustrations « .
Ces tourments se manifestent souvent par des nus violentés de sauvages coups de pinceaux, par la fugacité d’une scène et par l’impression que la beauté nous fuit encore et toujours …………
Pulpshaker. 2009
La consultation du texte complet sur le site Internet de Pulpshaker n’est plus possible car le nom du site a été revendu et son ancien contenu n’est plus consultable en ligne.
Avant sa disparition, ce contenu originel a été sauvé par nos soins. Ainsi, nous pouvons reproduire ci-dessous l’article tel qu’il était lors de sa première diffusion:
Jacques MIGAYROU.
De douloureuses réminiscences.
Des toiles sans titre, des personnages sans visages, un trait violent, sauvage, parfois flou, des jeux de lumières, le temps qui s’arrête, qui s’allonge, le trouble, le non-respect des proportions académiques, des couleurs fantaisistes… MIGAYROU peint les souvenirs, les réminiscences de l’enfance, les blessures, les déchirements qu’elle a causé et qui resteront à jamais gravé en lui. Une œuvre personnelle voire autobiographique ? Pas seulement, vous pourriez, vous aussi, vous reconnaître dans ses toiles…

Le parcours de Jacques MIGAYROU est pour le moins original. Intéressé par l’image depuis sa plus tendre enfance, il entre aux Beaux-Arts de Rennes, y acquiert une parfaite maîtrise du dessin et devient professeur d’arts plastiques. Finalement, mal à l’aise avec les couleurs, il plaque tout.
«La souplesse, la vivacité que j’avais avec le crayon je ne les retrouvais pas avec le pinceau. J’ai persévéré, mais un jour, lassé par la vacuité de mon travail, j’ai arrêté de peindre. »
Il connaît alors les frissons de la scène en devenant chanteur d’opéra et s’épanouit à travers quelques grands rôles du répertoire de baryton-basse. Rien que çà !
Pourtant, après dix ans sur les planches, MIGAYROU revient à ses premiers amours et s’empare à nouveau de son chevalet.
« La peinture est revenue en force. Peut-être est-ce le passage par la musique qui m’a fait prendre conscience que l’émotion pouvait aussi se cultiver avec elle. Je me suis remis au travail, et toile après toile j’ai avancé dans une recherche qui est pour moi l’aventure de ma vie. Chaque toile est une victoire. »
Le peintre lyonnais se met alors en quête d’émotions et tente de les capturer à la source des premiers souvenirs : l’enfance. D’ailleurs Jacques MIGAYROU nous confie peindre à partir de vieilles photos personnelles. Peindre devient alors une façon de revisiter ces images et l’émotion du souvenir qu’elles procurent.
Le thème de l’enfance ne se réduit pas à l’idée d’innocence et de pureté infantile, bien au contraire, il s’agit d’exprimer ce qu’appelle le peintre lui-même ses « tourments intérieurs ». Les traumatismes et les déchirures surgissent alors à travers la violence du trait et des couleurs.
«La beauté sauvagement blessée pour se venger de ne pas la posséder »
Ces derniers travaux traitent de la beauté inaccessible, source d’ «infinies frustrations » comme le qualifient les rédacteurs d’AZART (magazine bimensuel consacré à la peinture dont MIGAYROU a fait la première de couverture en mai dernier). Ces tourments se manifestent souvent par des nus violentés de sauvages coups de pinceaux, par la fugacité d’une scène, et par l’impression que la beauté nous fuit, encore et toujours.

Tous ces « dégoulissages », comme les nomme le peintre, constituent une certaine part de rage dans sa peinture. Il est vrai qu’on ne guérit jamais de l’enfance …
L’originalité et la profondeur de l’œuvre de Jacques MIGAYROU font de lui un peintre à découvrir de toute urgence.>
Pierre PICARD